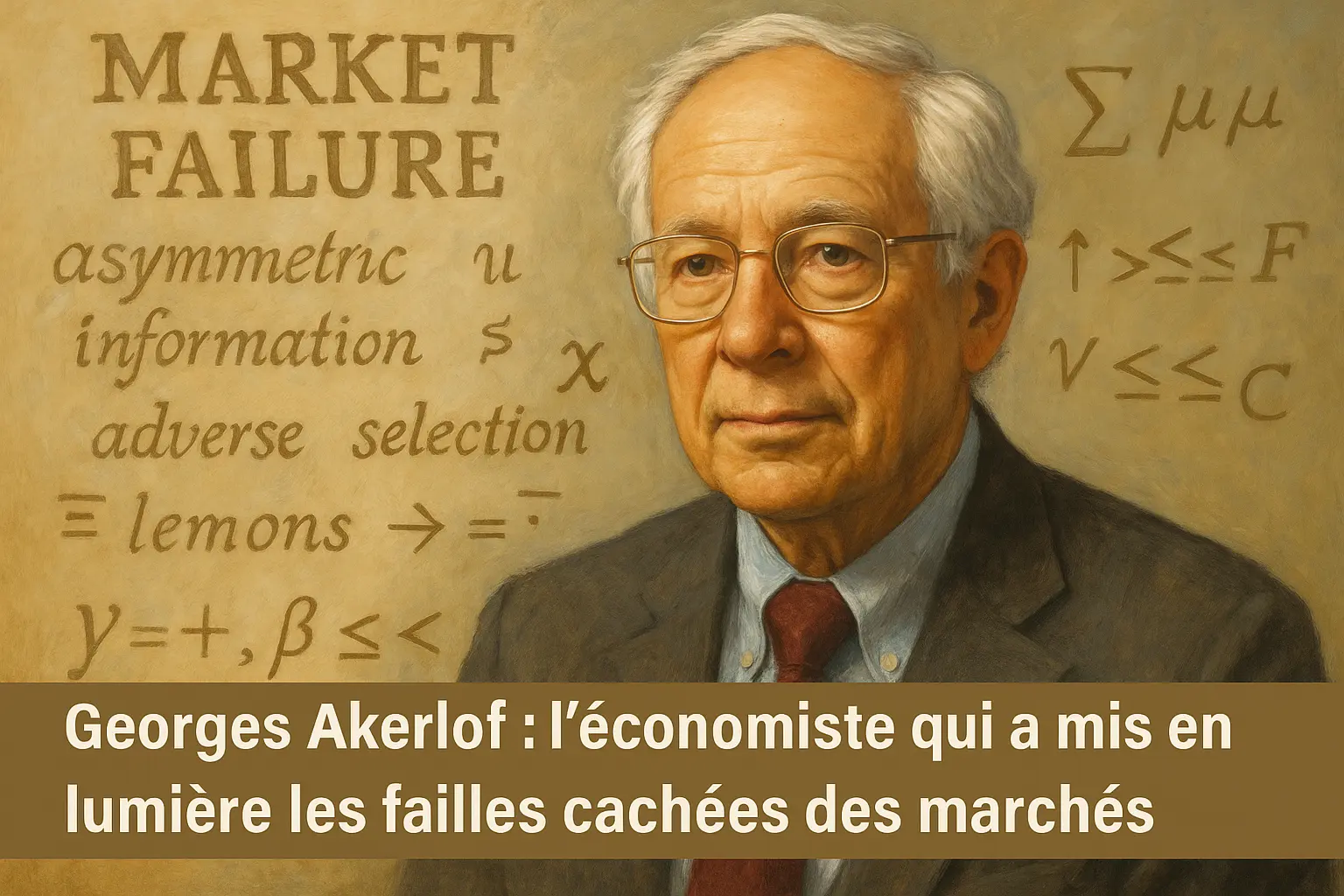1. Présentation générale
Georges Akerlof est un économiste américain né le 17 juin
1940 à New Haven (Connecticut, États-Unis). Il est toujours en vie.
Issu d’une famille d’intellectuels (son père était chimiste et sa mère
écrivaine), il s’intéresse très tôt à la recherche et à la science sociale.
Il a étudié à Yale University avant d’obtenir son doctorat
à l’université de MIT (Massachusetts Institute of Technology). Il a ensuite
enseigné dans plusieurs universités prestigieuses, notamment à Berkeley,
et a occupé des postes à la Réserve fédérale et à la Banque mondiale.
Ses domaines de prédilection sont l’économie de
l’information, la théorie des incitations, la sociologie économique et
l’analyse des comportements non rationnels. Il a notamment travaillé sur les
conséquences économiques de l’asymétrie d’information.
Il est surtout connu pour son article fondateur « The
Market for Lemons » publié en 1970, qui a introduit la notion d’asymétrie
d’information et a transformé la manière dont les économistes envisagent le
fonctionnement réel des marchés. Il a reçu le Prix Nobel d’économie en 2001,
partagé avec Michael Spence et Joseph Stiglitz.
2. Contexte historique et intellectuel
Georges Akerlof développe sa pensée économique dans la
seconde moitié du XXe siècle, une période marquée par de profonds
changements économiques et sociaux.
Dans les années 1960-1970, l’économie mondiale connaît une
transformation rapide. Aux États-Unis, le boom de l’après-guerre laisse
place à des périodes de stagflation (inflation + stagnation), notamment
après les chocs pétroliers de 1973 et 1979. Le modèle keynésien
traditionnel, qui avait dominé depuis les années 1940, montre alors ses limites
face à des problèmes que la théorie standard peine à expliquer, notamment le
chômage persistant malgré la relance.
C’est aussi l’époque où les économistes commencent à
remettre en question les hypothèses classiques de la rationalité parfaite
et de l’information parfaite. La théorie néoclassique dominante,
fondée sur des agents parfaitement informés et rationnels, devient de plus en
plus contestée.
Georges Akerlof s’inscrit précisément dans ce contexte. Il
cherche à comprendre comment les marchés fonctionnent réellement, et non
comme les modèles idéalisés les décrivent. Il introduit alors une idée
innovante : les informations ne sont pas toujours partagées équitablement
entre les acteurs économiques, ce qui peut fausser les échanges,
voire faire disparaître certains marchés.
Son travail est influencé par :
- la réalité
des marchés de biens d’occasion (ex. : voitures, logements),
- les
réflexions sur la confiance, les normes sociales et les comportements
non rationnels,
- et
un intérêt croissant pour les ponts entre économie et sociologie.
Son article « The Market for Lemons » paraît à un moment où
les économistes s’ouvrent à des analyses plus réalistes et empiriques. Il
participe à l’essor de ce que l’on appellera plus tard l’économie de
l’information et l’économie comportementale, deux courants qui
remettent en question les postulats classiques.
3. Principales idées et contributions
a) L’asymétrie d’information : "The Market for
Lemons" (1970)
C’est la contribution la plus célèbre d’Akerlof. Il y montre
qu’un marché peut disparaître ou dysfonctionner si les vendeurs en
savent beaucoup plus que les acheteurs sur la qualité des produits.
Exemple : dans le marché des voitures d’occasion, les
vendeurs savent si leur voiture est de bonne qualité ou si c’est une
"lemon" (une voiture défectueuse). Les acheteurs, eux, ne peuvent pas
faire la différence. Résultat : ils proposent un prix moyen. Les vendeurs
honnêtes refusent de vendre à ce prix trop bas… ne restent alors que les
mauvais produits. C’est le début de la sélection adverse.
Cette idée a profondément modifié la vision des économistes
sur la confiance, la transparence et les risques de défaillance des marchés.
b) L’économie et les normes sociales
Dans plusieurs travaux, Akerlof a souligné que les
comportements économiques sont influencés par des normes sociales et pas
seulement par le calcul rationnel d’un profit. Il s’éloigne ainsi de la vision
purement individualiste et utilitariste. Exemple : dans une entreprise,
certains salariés travaillent plus ou moins intensément selon ce qu’ils pensent
être "normal" ou "attendu" dans leur groupe, même si ce
n’est pas optimal pour eux individuellement.
Il contribue ainsi à l’essor d’une sociologie économique,
où la culture, les normes et les attentes collectives jouent un rôle dans les
décisions.
c) Le rôle de la confiance dans l’économie
Akerlof a insisté sur le fait que les marchés ne peuvent
fonctionner sans confiance. Lorsqu’elle disparaît (par exemple en cas de
scandales, d’opacité ou de crise), les échanges ralentissent voire cessent.
Exemple : lors de la crise des subprimes (2008), les
banques ont cessé de se prêter entre elles, faute de savoir si leurs
partenaires étaient solvables. Le manque de transparence a paralysé le système.
Cette analyse fait d’Akerlof un pionnier dans la réflexion
sur la fragilité des systèmes économiques, en cas de perte de repères ou
de transparence.
d) L’économie comportementale (Behavioral Economics)
Akerlof a aussi montré que les individus ne se comportent
pas toujours de façon rationnelle, mais qu’ils sont influencés par des
émotions, des routines, des erreurs de jugement. Il a collaboré avec Robert
Shiller pour approfondir ces recherches dans des ouvrages comme Animal
Spirits (2009).
Exemple : des ménages peuvent refuser d’acheter un
bien pourtant rentable, simplement par peur du changement, ou au contraire
acheter de manière irrationnelle par effet de mode.
Cela a permis de mieux comprendre les cycles économiques,
les bulles financières, ou encore les phénomènes de surconsommation.
4. Influence et postérité
L’œuvre de Georges Akerlof a profondément transformé la
manière dont les économistes abordent les marchés et les comportements des
agents économiques. Son influence est multiple, à la fois théorique, pratique,
et institutionnelle.
a) Une rupture dans la théorie néoclassique
En montrant que l’asymétrie d’information pouvait
mener à l’échec du marché, Akerlof a remis en cause l’idée que les marchés sont
toujours efficaces lorsqu’ils sont laissés à eux-mêmes. Il a contribué à nuancer
la vision libérale classique, et à souligner la nécessité de régulations
ou d’institutions pour garantir la transparence.
Son approche a été reprise, développée et enrichie par Joseph
Stiglitz et Michael Spence, avec qui il partage le Prix Nobel
d’économie en 2001. Ce prix a consacré un nouveau champ de recherche
: l’économie de l’information.
b) Une influence sur les politiques publiques
Les travaux d’Akerlof ont des applications concrètes
en matière de régulation des marchés. Par exemple :
- Les
obligations d’information imposées aux vendeurs dans les marchés de
biens (voitures, logement, alimentation…) s’inspirent directement de ses
analyses.
- Les
politiques de lutte contre les asymétries (transparence bancaire,
contrôle des médicaments, étiquetage…) reposent sur ses idées.
- Il a
aussi conseillé des institutions comme la Banque mondiale ou la Réserve
fédérale américaine, où il a milité pour une meilleure prise en compte
des facteurs psychologiques et sociaux dans les politiques
économiques.
c) Une inspiration pour les sciences sociales
En intégrant les normes sociales, la confiance ou les
comportements non rationnels dans ses modèles, Akerlof a contribué à rapprocher
l’économie de la psychologie et de la sociologie. Il a ouvert la voie à
des courants comme :
- L’économie
comportementale (avec Kahneman, Thaler, Shiller…),
- La
sociologie économique (où les réseaux, les valeurs et les normes
influencent les échanges),
- Les
sciences cognitives appliquées à la décision économique.
d) Des idées toujours actuelles
Aujourd’hui, les réflexions d’Akerlof restent d’une grande
actualité pour comprendre :
- La crise
de 2008, et la perte de confiance dans le système financier,
- Les
limites de certains marchés numériques (ex. : fausses évaluations en
ligne, opacité des algorithmes),
- Les
défis liés à la régulation de l’information sur internet, aux
arnaques ou à la désinformation économique.
5. À retenir
Georges Akerlof est un économiste américain né en
1940, prix Nobel en 2001, connu pour ses travaux sur l’information imparfaite
et les comportements économiques non rationnels.
Il a démontré que l’asymétrie d’information
(lorsqu’un acteur en sait plus qu’un autre sur un produit ou une situation)
peut faire échouer un marché. Son article The Market for Lemons
est une référence fondatrice.
Il a introduit l’idée que les normes sociales, la confiance
et les émotions jouent un rôle essentiel dans les décisions économiques,
au-delà des simples calculs rationnels.
Ses recherches ont donné naissance à l’économie de
l’information et ont nourri l’économie comportementale et la sociologie
économique.
Son influence est forte sur les politiques publiques
modernes : régulation des marchés, obligation de transparence, lutte contre les
déséquilibres d’information.
Ses idées restent très utilisées pour comprendre les
crises financières, les défauts de transparence sur les marchés, ou les
effets sociaux des décisions économiques.
6. Citations emblématiques
« Le marché peut fonctionner si, et seulement si, les
acheteurs peuvent faire confiance aux vendeurs. »
— Georges Akerlof, résumé de The Market for Lemons
Cette citation illustre bien le cœur de sa pensée : sans
information fiable, la logique marchande s’effondre. Elle souligne que la
confiance est une condition fondamentale de tout échange économique.
Autre citation marquante (coécrite avec Robert Shiller) :
« Les esprits animaux sont à l'origine de la majeure
partie de l'activité économique. »
— Animal Spirits, 2009
Ici, Akerlof remet en cause l’idée que les individus sont
toujours rationnels. Il insiste sur l’impact des émotions, intuitions, peurs
et espoirs sur les décisions économiques.
7. Pour aller plus loin – Exemples contemporains
Les idées de Georges Akerlof continuent d’éclairer des
enjeux économiques très actuels, notamment à l’heure du numérique, des
crises financières et de l'économie comportementale.
a. Plateformes numériques et asymétrie d’information
Sur des sites comme Vinted, Leboncoin ou Amazon
Marketplace, les acheteurs n’ont pas toujours accès à une information
fiable sur les produits. Pour compenser cette asymétrie, on utilise :
- des évaluations
(étoiles, commentaires),
- des garanties
de remboursement,
- des systèmes
de notation des vendeurs.
Ces mécanismes de réputation illustrent directement
les solutions proposées par Akerlof pour éviter les effets pervers du type
"lemons".
b. Crises de confiance et finance
La crise financière de 2008 a confirmé l’importance
du rôle de la confiance. Les banques ont cessé de se prêter entre elles,
car elles ignoraient l’état réel des bilans de leurs partenaires. Cela a
provoqué un blocage des marchés interbancaires, illustrant parfaitement
les effets destructeurs d’une perte d’information et de confiance.
Les politiques post-crise ont donc renforcé les règles de transparence
financière (ex. : Bâle III, stress tests bancaires).
c. Santé, alimentation et information biaisée
Dans le domaine de la santé ou de l’alimentation, les
consommateurs sont souvent mal informés. Pour éviter des effets de sélection
adverse (produits nocifs ou trompeurs), les États imposent :
- l’étiquetage
nutritionnel,
- la réglementation
des médicaments,
- des normes
de qualité.
Ici encore, Akerlof nous aide à comprendre pourquoi les
marchés ne peuvent pas s’autoréguler sans cadre clair.
d. Économie comportementale et politique publique
Les travaux d’Akerlof ont aussi inspiré la création de
"nudge units" (cellules d’incitation comportementale), notamment au
Royaume-Uni, en France ou dans les institutions européennes. Elles utilisent
les mécanismes psychologiques pour aider les individus à prendre de
meilleures décisions (ex. : pour l’épargne, la santé ou l’environnement).
Ces politiques ne visent pas à contraindre, mais à orienter
les comportements en s’appuyant sur les biais cognitifs.
Ouvrages pour prolonger la réflexion :
- The
Market for Lemons (1970) – Article fondateur.
- Animal
Spirits (2009, avec Robert Shiller) – Sur le rôle des émotions dans
l’économie.
- Identity
Economics (2010, avec Rachel Kranton) – Sur l’identité sociale et les
décisions économiques.