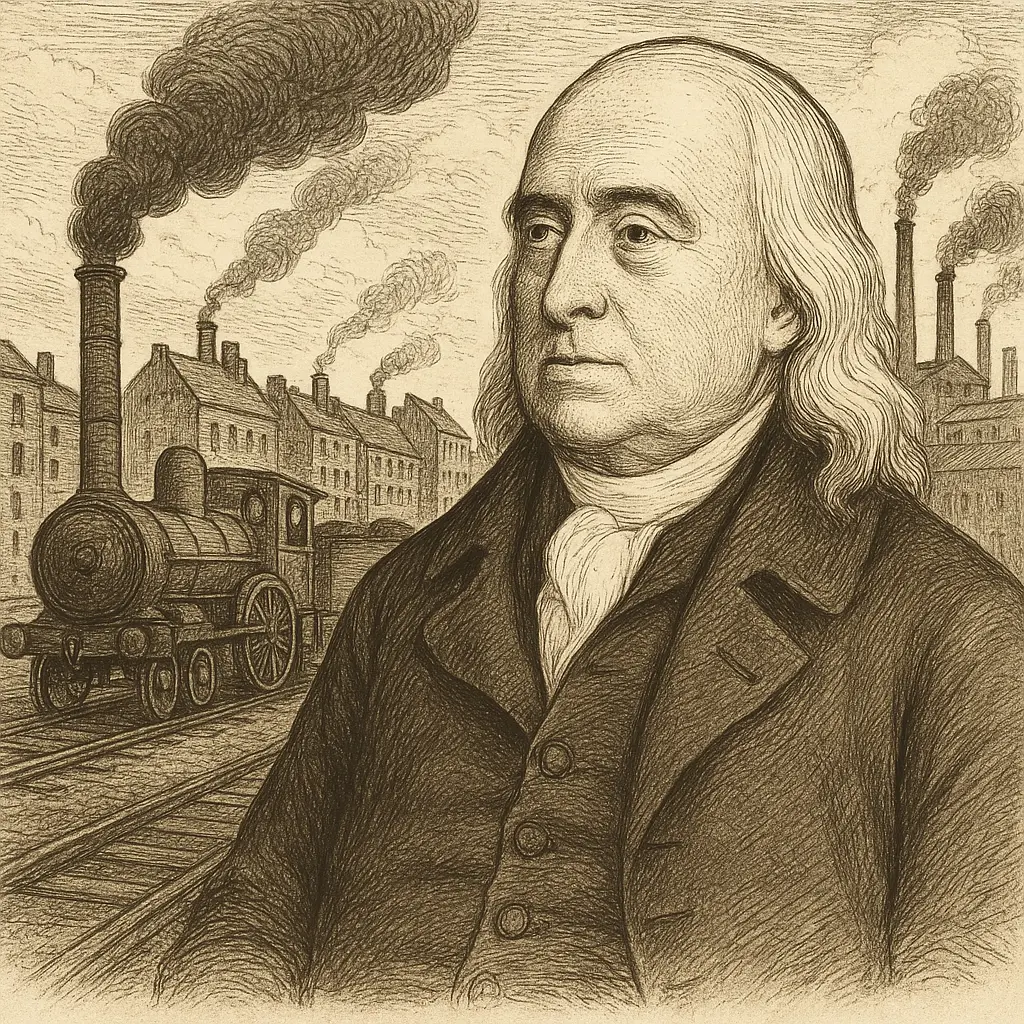1. Présentation générale
Nom complet : Jeremy Bentham
Dates : 15 février 1748 – 6 juin 1832
Nationalité : Britannique
Domaine : Philosophie morale, économie, droit et théorie politique.
Jeremy Bentham est l’un des fondateurs de l’utilitarisme,
une doctrine morale et politique qui affirme que les décisions doivent viser «
le plus grand bonheur du plus grand nombre ». Juriste et réformateur, il a
appliqué cette idée à l’économie, au droit et aux institutions, cherchant à
rationaliser les politiques publiques.
Sa pensée se distingue par une approche pragmatique et
mesurable : évaluer les lois, les réformes ou les actions selon leurs
conséquences concrètes sur le bien-être collectif. Pour les élèves de SES et du
Baccalauréat International, Bentham est un auteur-passerelle entre philosophie
morale et analyse économique, utile pour comprendre comment les
valeurs influencent les choix économiques et politiques.
2. Contexte historique et intellectuel
Jeremy Bentham vit entre la seconde moitié du XVIIIᵉ siècle
et le début du XIXᵉ siècle, une période marquée par des bouleversements
profonds. Sur le plan économique, c’est l’époque de la première
Révolution industrielle en Grande-Bretagne : mécanisation du textile, essor du
charbon et de la sidérurgie, urbanisation rapide. Ces transformations stimulent
la production, mais accentuent aussi les inégalités sociales et les problèmes
sanitaires dans les villes.
Sur le plan social et politique, Bentham évolue dans
un contexte d’expansion coloniale britannique et de tensions internationales
liées aux guerres napoléoniennes. En Europe, les idées des Lumières circulent
largement, mettant l’accent sur la raison, les droits naturels et la réforme des
institutions. La Révolution française (1789) et ses idéaux de liberté et
d’égalité marquent son époque, même si Bentham critique certains excès
révolutionnaires au nom de la stabilité et de l’efficacité.
Les courants dominants dans lesquels s’inscrit
Bentham sont multiples :
- En
philosophie morale, il s’oppose à l’éthique fondée sur la tradition ou la
religion, au profit d’une morale conséquentialiste (juger une
action à ses résultats).
- En
économie, il est contemporain des classiques (Adam Smith, David
Ricardo) qui mettent en avant le marché comme mécanisme central
d’allocation des ressources.
- En
droit et politique, il combat le droit coutumier et plaide pour des lois
écrites, claires et fondées sur l’intérêt collectif.
Bentham occupe ainsi une position transversale : il
partage avec les économistes classiques l’idée d’efficacité et de rationalité
dans l’organisation sociale, mais il introduit un critère moral précis – la
maximisation du bonheur collectif – comme boussole pour évaluer les
institutions, là où les économistes de son temps se concentrent surtout sur la
richesse et la production.
3. Principales idées et contributions
Version simple (accessible aux débutants)
Jeremy Bentham est surtout connu pour l’utilitarisme, l’idée que toute
action ou loi doit être jugée selon une question : « Produit-elle plus de
bonheur que de malheur pour la société ? »
Pour mesurer cela, il propose une forme de "calcul du bonheur"
: évaluer l’intensité, la durée, la certitude et l’étendue du plaisir ou de la
peine produits.
Version avancée (pour niveaux Première, Terminale et IB)
Bentham formalise ce qu’il appelle le principe d’utilité : une action
est bonne si elle maximise la somme des satisfactions et minimise la somme des
souffrances pour l’ensemble des individus concernés. Ce principe s’applique
aussi bien aux décisions politiques qu’aux choix économiques.
Il conçoit un "hedonic calculus" (calcul hédoniste) qui
cherche à quantifier le bien-être en fonction de sept critères : intensité,
durée, certitude, proximité, fécondité, pureté, étendue.
Bentham insiste sur le fait que chaque individu compte de manière égale
(« chacun compte pour un, personne pour plus d’un »), ce qui le rapproche de
certains idéaux démocratiques.
Ouvrages majeurs
- An
Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789) :
expose le principe d’utilité et la méthode du calcul hédoniste.
- Panopticon
(1791) : projet de prison permettant une surveillance totale, qui illustre
sa volonté d’efficacité dans les institutions.
- Écrits
sur les réformes juridiques, l’éducation, et l’économie, toujours guidés
par l’évaluation des conséquences.
Exemples concrets
- Politique
fiscale : pour Bentham, un impôt juste est celui qui minimise la
souffrance économique tout en finançant des biens publics utiles au plus
grand nombre.
- Santé
publique : la vaccination, si elle prévient plus de souffrances
qu’elle ne cause d’effets négatifs, est moralement justifiable.
- Législation
pénale : les peines doivent être proportionnelles et conçues pour
décourager les crimes, non pour se venger.
Lien direct avec programme SES / IB
- SES
– Seconde : Thème "Science économique et sociologie" →
discuter du lien entre valeurs et choix économiques.
- SES
– Première : Chapitre "Comment se forment les prix sur un
marché" et "Quelles sont les principales sources et défis de la
croissance" → introduire la notion de bien-être collectif dans
l’évaluation des politiques économiques.
- SES
– Terminale : Chapitre "Économie du développement durable"
et "Politiques économiques dans l’UE" → Bentham permet d’aborder
la notion de maximisation du bien-être et de choix collectifs rationnels.
- IB
Economics – SL et HL :
- Microeconomics
– Market failure → évaluer les interventions publiques selon leur
impact sur le bien-être social.
- Macroeconomics
– Demand-side policies → analyser les effets des politiques
budgétaires et monétaires sur la satisfaction collective.
- Development
Economics – Measuring development → discuter de la pertinence
d’indicateurs de bien-être (IDH, indicateurs subjectifs) inspirés de la
logique benthamienne.
Bentham sert ainsi de passerelle pédagogique pour
comprendre comment un raisonnement moral peut être intégré dans l’analyse
économique, et pourquoi l’évaluation des politiques ne se limite pas à mesurer
la production ou la croissance.
4. Influence et postérité
Impact sur la pensée économique et sur les politiques
publiques
Jeremy Bentham a marqué durablement la philosophie politique et l’économie par
l’introduction d’un critère clair pour juger l’action publique : maximiser
le bien-être collectif. Son utilitarisme a influencé la conception des
politiques sociales, la réforme du droit pénal et civil, et l’idée que les lois
doivent se fonder sur des critères rationnels et mesurables. En économie, sa
pensée ouvre la voie aux approches modernes qui cherchent à mesurer la
satisfaction ou le bien-être, préfigurant certaines notions de bien-être
social utilisées aujourd’hui.
Influence sur d’autres auteurs ou courants
Bentham a inspiré directement John Stuart Mill, qui a affiné
l’utilitarisme en distinguant les plaisirs de « qualité supérieure »
(intellectuels, moraux) et ceux de « qualité inférieure » (physiques). Il
influence aussi l’économie du bien-être développée au XXᵉ siècle par des
économistes comme Vilfredo Pareto ou Arthur Pigou, qui cherchent
à formaliser et quantifier l’utilité collective. Ses idées se retrouvent
également dans les approches modernes de la cost-benefit analysis
(analyse coûts-avantages) utilisées par les gouvernements et les organisations
internationales pour évaluer les projets.
Débats et controverses
Bentham est critiqué pour avoir réduit les valeurs humaines à des calculs de
plaisir et de peine, ce qui peut sembler réducteur et insensible
à la dignité humaine ou aux droits inaliénables. Certains philosophes lui
reprochent une vision trop quantitative du bonheur, incapable de prendre en
compte la diversité et la complexité des aspirations humaines. Sur le plan
politique, son projet du Panopticon est souvent cité comme un exemple
inquiétant d’obsession pour l’efficacité au détriment des libertés
individuelles.
Actualité de ses idées
Aujourd’hui, la pensée benthamienne reste centrale dans les discussions sur l’économie
comportementale, la politique environnementale ou la santé
publique. Les débats sur le bien-être national brut, le revenu universel,
ou la tarification carbone s’appuient sur une logique proche de la sienne :
mesurer et maximiser le bénéfice net pour la société. Dans le contexte du
changement climatique, par exemple, un raisonnement utilitariste permet de
justifier des mesures contraignantes si elles préviennent des dommages massifs
pour les générations futures.
5. Applications contemporaines
Exemples récents en lien avec ses idées
- Analyse
coûts-avantages des politiques publiques : lorsqu’un gouvernement
décide d’investir dans une ligne de train à grande vitesse, il calcule les
gains (réduction du temps de trajet, baisse des émissions, développement
économique) et les compare aux coûts (construction, entretien, impact
environnemental). Cette approche est directement héritée du calcul
utilitariste de Bentham.
- Politiques
de santé : pendant la pandémie de COVID-19, de nombreux pays ont
justifié les confinements ou les campagnes vaccinales par l’idée que les
bénéfices pour la santé publique dépassaient les inconvénients économiques
et sociaux.
- Transition
écologique : les taxes carbone et les subventions aux énergies
renouvelables s’appuient sur un raisonnement benthamien : supporter un
coût aujourd’hui pour éviter des dommages plus importants demain.
Comparaison avec d’autres théories
- Contrairement
au libéralisme économique pur (inspiré d’Adam Smith), qui laisse le
marché décider des choix optimaux, Bentham insiste sur le rôle actif de
l’État pour corriger les situations où le marché ne maximise pas le
bonheur collectif.
- Par
rapport à la théorie des droits naturels (John Locke),
l’utilitarisme est moins centré sur les libertés inaliénables et davantage
sur les conséquences mesurables.
- Face
à la vision marxiste, Bentham ne remet pas en cause le capitalisme
comme système, mais cherche à l’améliorer par des lois et institutions qui
maximisent le bien-être.
6. Limites et critiques
Critiques contemporaines à l’époque
De son vivant, Jeremy Bentham a été perçu par certains comme un penseur
radical, trop en rupture avec les traditions morales et juridiques. Les
défenseurs du droit coutumier et des institutions héritées craignaient que sa
volonté de tout mesurer en termes d’utilité conduise à ignorer des principes
fondamentaux comme la justice ou la liberté individuelle. Son projet de Panopticon,
bien qu’innovant en matière de surveillance et d’efficacité, a suscité des
inquiétudes sur un possible contrôle excessif des citoyens par l’État.
Critiques modernes
Aujourd’hui, l’utilitarisme benthamien est souvent jugé réducteur car il
réduit le bien-être à une addition de plaisirs et de peines mesurables.
Plusieurs critiques reviennent régulièrement :
- Problème
de la mesure : le « calcul hédoniste » est difficile à appliquer dans
la réalité, car le bonheur et la souffrance sont subjectifs et varient
selon les individus et les cultures.
- Tyrannie
de la majorité : une décision qui maximise le bonheur global peut
léser gravement une minorité. Par exemple, sacrifier les intérêts de
quelques-uns pour améliorer le bien-être de la majorité peut être
moralement inacceptable.
- Absence
de prise en compte qualitative : contrairement à John Stuart Mill,
Bentham ne distingue pas entre des plaisirs de nature différente
(culturels, intellectuels, matériels), ce qui peut conduire à traiter tous
les gains de manière équivalente, même s’ils n’ont pas la même valeur
morale ou sociale.
- Risques
politiques : une application rigide pourrait justifier des politiques
intrusives ou liberticides au nom du bien-être collectif, comme dans
certaines législations de santé publique ou de sécurité.
Limites d’application
Dans un contexte économique et politique complexe, l’utilitarisme benthamien
doit souvent être complété par d’autres approches, comme la défense des droits
fondamentaux ou la recherche d’équité. Les économistes et décideurs publics
utilisent parfois son raisonnement comme outil d’évaluation, mais
rarement comme unique boussole pour décider.
7. À retenir (synthèse finale)
Points-clés
- Jeremy
Bentham est le fondateur de l’utilitarisme : juger les actions
selon leurs conséquences sur le bonheur collectif.
- Il
propose un calcul hédoniste pour mesurer plaisir et peine, et
orienter les décisions publiques.
- Ses
idées influencent la réforme du droit, les politiques publiques et
l’économie du bien-être.
- Ses
approches restent utilisées dans l’analyse coûts-avantages des
projets publics.
- Sa
vision est critiquée pour sa simplification excessive du bonheur et ses
risques pour les libertés individuelles.
Termes importants à connaître
- Principe
d’utilité : agir pour maximiser le bonheur et minimiser la souffrance.
- Calcul
hédoniste : méthode d’évaluation des plaisirs et peines générés par
une action.
- Conséquentialisme
: doctrine morale jugeant les actes à leurs résultats.
- Économie
du bien-être : branche de l’économie qui évalue les politiques en
fonction de leur impact sur le bien-être social.
8. Citations emblématiques
- «
Le plus grand bonheur du plus grand nombre est la mesure du bien et du
mal. »
Source : An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789), chapitre I.
Contexte : cette formule résume le principe d’utilité, fondement de l’utilitarisme benthamien. Bentham y expose que toute action ou loi doit être évaluée selon sa capacité à maximiser le bonheur global et à réduire la souffrance. - «
Chacun compte pour un, et personne pour plus d’un. »
Source : Attribution courante à Bentham dans les interprétations de son utilitarisme, reprise notamment par John Stuart Mill (Utilitarianism, 1861).
Contexte : ce principe d’égalité de considération est implicite dans l’œuvre de Bentham : chaque individu doit être pris en compte de manière égale dans le calcul du bien-être collectif, sans privilège ni discrimination. - «
La question n’est pas : peuvent-ils raisonner ? Ni : peuvent-ils parler ?
Mais : peuvent-ils souffrir ? »
Source : An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789), chapitre XVII, note de bas de page sur les animaux.
Contexte : Bentham élargit ici l’utilitarisme aux animaux, considérant la capacité à souffrir comme critère moral central. C’est une idée précurseure dans les débats contemporains sur le bien-être animal et l’éthique environnementale.
10. Pour aller plus loin
Ouvrages de Bentham
- An
Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789) –
Présentation complète du principe d’utilité et du calcul hédoniste.
- Panopticon
(1791) – Projet architectural et institutionnel pour une prison basée sur
la surveillance permanente.
- Deontology,
or the Science of Morality (publié à titre posthume en 1834) –
Développement de sa réflexion sur la morale appliquée.
Ouvrages et ressources sur Bentham
- Burns,
J. H., Bentham and the Ethics of Today – Analyse de la pertinence
contemporaine de l’utilitarisme.
- Crimmins,
James E., Utilitarian Philosophy and Politics: Bentham's Later Years
– Approfondissement de son impact politique.
- University
College London – Bentham Project : archives, correspondances et
manuscrits numérisés.
Ressources pédagogiques
- SEP
(Stanford Encyclopedia of Philosophy), article « Jeremy Bentham » –
Présentation universitaire de référence.
- BBC In Our Time – Podcast «
Utilitarianism » avec discussion sur Bentham et Mill.