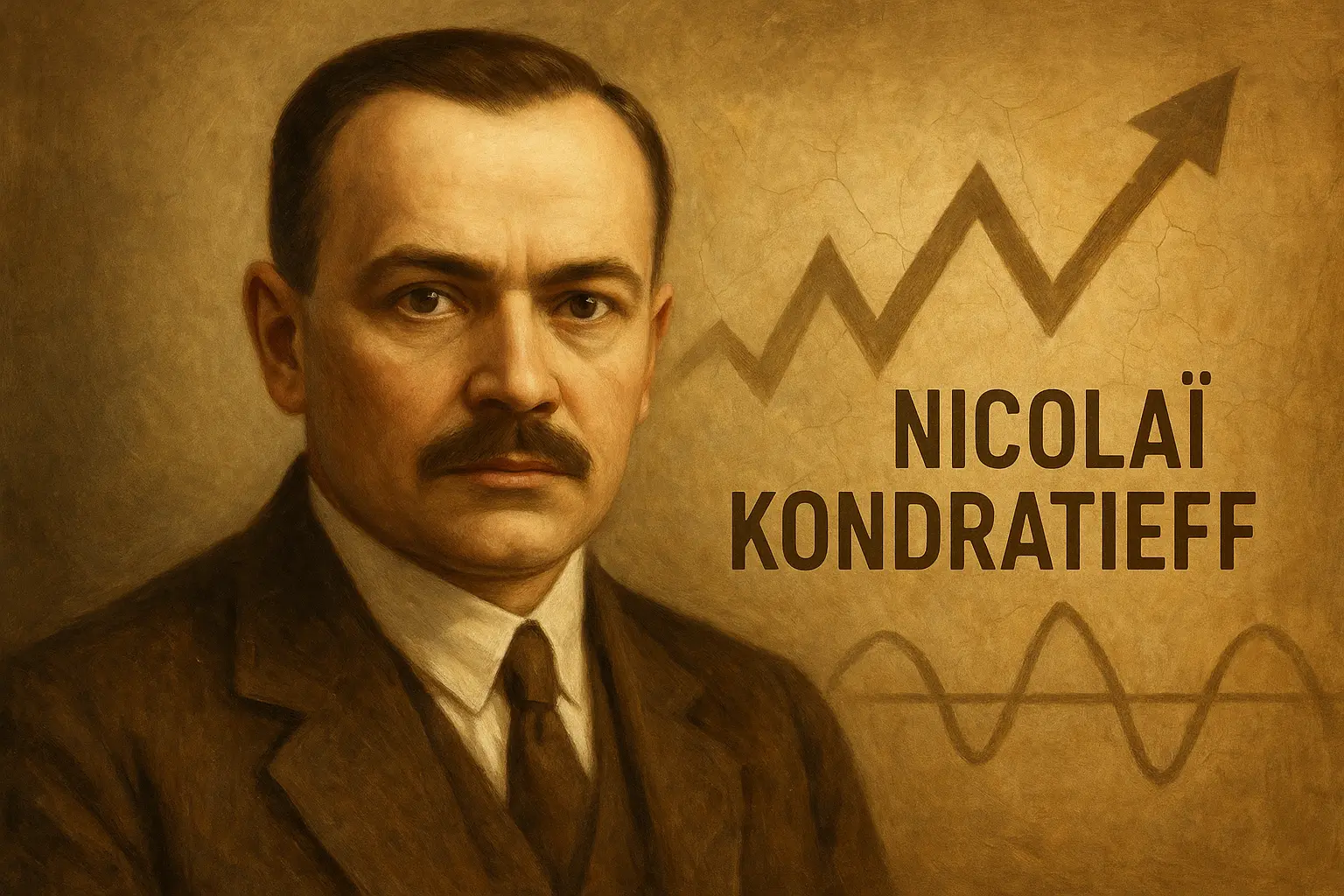1. Présentation générale
Nicolaï Dimitrievitch Kondratieff est un économiste russe né
le 4 mars 1892 dans le village de Galuevka, situé dans la province de
Kostroma, en Russie, et mort exécuté le 17 septembre 1938 à Moscou,
pendant les Grandes Purges staliniennes.
Issu d’une famille paysanne modeste, il parvient grâce à son
mérite à intégrer l’Université de Saint-Pétersbourg, où il se spécialise en
économie et en statistique.
Après la Révolution d’Octobre 1917, Kondratieff occupe
plusieurs fonctions dans l’administration économique soviétique. Il fonde
notamment l’Institut de Conjoncture de Moscou, une institution pionnière
consacrée à l’étude des cycles économiques et des prévisions à long terme.
Ses travaux portent principalement sur :
- L’analyse
statistique de l’économie (production, prix, commerce),
- Les
cycles longs dans l’activité économique,
- L’agriculture
et la planification.
Il est surtout connu pour avoir formulé la théorie des «
cycles de Kondratieff », de longs cycles d’environ 40 à 60 ans, qui
alternent des phases de croissance et de dépression économique. Cette idée
reste aujourd’hui associée à son nom et fait de lui l’un des premiers
économistes à proposer une lecture cyclique de l’histoire économique mondiale.
2. Contexte historique et intellectuel
Nicolaï Kondratieff a vécu dans une période particulièrement
tourmentée de l’histoire de la Russie et du monde.
La Russie impériale en crise
Au moment de sa naissance, l’Empire russe est encore marqué par :
- Une
économie principalement agricole et peu industrialisée,
- De
fortes inégalités sociales,
- Des
tensions politiques qui mèneront à la Révolution de 1905, puis à la
Révolution de 1917.
La Révolution bolchevique et la guerre civile
En 1917, la Révolution d’Octobre renverse le régime tsariste et instaure un
gouvernement communiste. Entre 1917 et 1922, la guerre civile russe oppose les
bolcheviks (rouges) aux forces contre-révolutionnaires (blancs), causant des
millions de morts et d’importantes destructions économiques.
La période de la NEP (Nouvelle Politique Économique)
Pour relancer l’économie exsangue, Lénine met en place en 1921 la NEP, une
politique plus pragmatique autorisant un certain retour de la propriété privée
et du marché. C’est durant cette période que Kondratieff développe ses
recherches, bénéficiant d’un climat intellectuel un peu plus ouvert.
L’internationalisation des échanges et la crise mondiale
Sur le plan mondial, Kondratieff observe :
- La
première mondialisation des échanges (fin XIXe - début XXe siècle),
- Les
cycles d’expansion industrielle en Europe et aux États-Unis,
- L’importance
croissante des innovations technologiques (électricité, automobile,
chimie).
Les débuts de la planification économique
En URSS, l’idée de planifier scientifiquement la production gagne en influence.
Kondratieff fonde l’Institut de Conjoncture précisément pour fournir des
données objectives et anticiper les fluctuations économiques.
Les Grandes Purges
Quand Staline prend le pouvoir absolu à partir de la fin des années 1920, le
climat change brutalement. Toute recherche qui peut sembler critique envers la
planification étatique devient suspecte. La thèse de Kondratieff sur les cycles
longs (qui implique des périodes inévitables de déclin économique) est perçue
comme politiquement dangereuse. Il est arrêté en 1930, emprisonné et finalement
exécuté en 1938.
Impact sur sa pensée
Les bouleversements politiques et économiques, la transformation rapide de la
société russe, et l’observation des crises mondiales nourrissent son intérêt
pour l’étude des rythmes longs de l’économie et la recherche de lois cycliques
qui permettraient de prévoir et peut-être d’atténuer ces crises.
3. Principales idées et contributions
a) La théorie des cycles longs
(les « cycles de Kondratieff »)
Explication simple :
Kondratieff propose que l’économie mondiale ne se développe pas de manière
linéaire, mais selon de longs cycles d’environ 40 à 60 ans, alternant
des phases d’expansion et de dépression.
Chaque cycle est déclenché par des grandes innovations technologiques qui
stimulent l’investissement et la production, avant de connaître un
ralentissement puis un repli prolongé.
Exemple concret :
- Phase
ascendante : fin du XIXe siècle, industrialisation rapide grâce au chemin
de fer et à l’électricité.
- Phase
descendante : crise des années 1920-1930.
Impact :
Cette idée a marqué la pensée économique en suggérant que les crises ne sont
pas de simples accidents, mais des phénomènes structurels et prévisibles.
b) L’importance de
l’innovation et des technologies
Explication simple :
Selon Kondratieff, l’arrivée de nouvelles technologies (énergie, transports,
communications) crée un cycle d’investissement massif, qui entraîne la
croissance.
Quand ces innovations sont diffusées et banalisées, la croissance ralentit.
Exemple contemporain :
Le développement d’internet dans les années 1990-2000 a créé une phase de
croissance technologique comparable à un « cycle long ».
Impact :
Cette idée inspire encore aujourd’hui les économistes qui analysent les vagues
d’innovation (numérique, intelligence artificielle, énergies renouvelables).
c) La nécessité d’études
statistiques rigoureuses
Explication simple :
Kondratieff insiste sur l’importance d’observer les données sur plusieurs
décennies pour comprendre les tendances profondes, au lieu de se limiter aux
fluctuations annuelles.
Exemple concret :
Il a utilisé des séries longues de prix agricoles, de production industrielle
et de commerce mondial pour étayer sa théorie.
Impact :
Cette démarche a contribué à poser les bases de l’analyse des cycles
économiques, toujours utilisée aujourd’hui en macroéconomie et en
prévision.
d) L’idée que les cycles sont
inévitables
Explication simple :
Contrairement à la vision marxiste dominante en URSS, Kondratieff estimait
qu’aucun système économique (même le socialisme) ne pouvait abolir les cycles.
Les expansions et les récessions sont liées à des phénomènes de long terme,
comme l’épuisement des innovations et la saturation des marchés.
Exemple concret :
Même les pays communistes ont connu des ralentissements économiques, confirmant
en partie ses observations.
Impact :
C’est cette thèse qui a provoqué la méfiance des autorités soviétiques et
conduit à sa disgrâce.
e) La dimension mondiale des
cycles
Explication simple :
Kondratieff affirme que les cycles sont internationaux : ils affectent
simultanément plusieurs pays, car les économies sont interconnectées par le
commerce et les investissements.
Exemple concret :
La Grande Dépression des années 1930 a touché l’Europe, l’Amérique et l’Asie.
Impact :
Cette approche globale est précurseur des analyses contemporaines de la
mondialisation et de la synchronisation des crises.
f) La structure interne des
cycles longs et leur articulation avec les cycles courts
Explication simple :
Kondratieff a montré que chaque cycle long n’était pas uniforme, mais se
divisait en plusieurs phases :
1️⃣ Phase d’expansion (environ 20 à 25 ans)
- Forte
croissance économique.
- Diffusion
rapide d’innovations majeures (par exemple, la machine à vapeur,
l’électricité, l’informatique).
2️⃣ Phase de retournement
- Court
ralentissement de la conjoncture.
- Les
premiers signes de saturation apparaissent (baisse de rentabilité,
surproduction).
3️⃣ Phase de dépression
(environ 20 à 25 ans)
- Stagnation
ou baisse de l’activité.
- Chômage
élevé, faible investissement.
- Préparation
des innovations futures qui relanceront un nouveau cycle.
Exemple concret :
Le cycle commencé vers 1896 avec l’essor de l’électricité et de la chimie fine
se termine par la Grande Dépression des années 1930.
Les cycles courts qui se superposent :
Pendant ces cycles longs, Kondratieff et d’autres économistes ont observé
l’existence de cycles plus courts (d’environ 10 ans), appelés cycles des
affaires ou cycles Juglar, qui provoquent :
- Des
récessions ponctuelles même au sein d’une phase d’expansion,
- Des
rebonds temporaires dans une phase de dépression.
Ces fluctuations plus brèves n’annulent pas le mouvement de
fond des cycles longs.
Le caractère empirique de sa découverte :
Kondratieff n’a pas construit sa théorie sur des hypothèses abstraites :
- Il
a collecté et analysé les données des prix, de la production et des
échanges commerciaux en France, Grande-Bretagne, Allemagne et
États-Unis, de 1770 à 1920.
- Il
a constaté la régularité de ces grands mouvements dans plusieurs pays
industrialisés.
L’interprétation théorique de Schumpeter :
C’est l’économiste Joseph Schumpeter qui a popularisé et enrichi ses
travaux en y apportant une explication :
- Selon
Schumpeter, ces cycles longs résultent de vagues d’innovations
radicales, qui entraînent une phase d’expansion puis, une fois leur
potentiel épuisé, une phase de dépression.
- Il
appelle ce processus la destruction créatrice, où les anciennes
industries disparaissent pour laisser place aux nouvelles.
Impact :
Ces apports ont renforcé l’importance de Kondratieff dans l’histoire de la
pensée économique et ont fait de ses cycles un outil d’analyse toujours discuté
aujourd’hui.
4. Influence et postérité
Sur les politiques publiques et la société
À son époque, les idées de Kondratieff ont eu peu d’influence sur les
politiques soviétiques. Ses travaux étaient jugés suspects car ils remettaient
en cause la doctrine officielle selon laquelle le socialisme éliminerait les
crises.
En revanche, après sa mort, sa théorie a trouvé un large écho dans les pays
occidentaux, notamment parmi les économistes et les prévisionnistes cherchant à
comprendre les cycles économiques de long terme.
Sur d’autres auteurs et écoles de pensée
Ses travaux ont inspiré de nombreux chercheurs et théoriciens :
- Joseph
Schumpeter, qui s’est appuyé sur les cycles de Kondratieff pour
développer sa propre théorie des cycles économiques fondés sur
l’innovation et la « destruction créatrice ».
- Les
économistes de la School of Long Waves, qui étudient encore
aujourd’hui l’influence des grandes vagues technologiques sur la
croissance.
- Les
chercheurs en prospective économique, qui s’efforcent d’anticiper les
phases ascendantes et descendantes des cycles mondiaux.
Actualité de ses idées aujourd’hui
Les cycles de Kondratieff sont toujours cités pour analyser :
- L’essor
et le ralentissement des grandes révolutions industrielles (chemin de fer,
électricité, informatique, numérique).
- Les
crises systémiques comme celle de 1929 ou de 2008, qui apparaissent comme
des moments de transition entre deux cycles.
- Les
perspectives d’un nouveau cycle long porté par les énergies renouvelables
et les technologies vertes.
Si sa théorie n’est pas acceptée par tous les économistes
(certains contestent la régularité et la prévisibilité des cycles), elle reste
une référence majeure pour réfléchir aux dynamiques de long terme dans
l’économie mondiale.
5. À retenir (synthèse)
✅ Nicolaï Kondratieff
(1892-1938) est un économiste russe spécialiste des cycles économiques de
longue durée.
✅ Il est connu pour avoir
développé la théorie des « cycles de Kondratieff », de longs cycles de
40 à 60 ans alternant croissance et dépression.
✅ Il a montré que ces cycles sont
liés à l’émergence et à la diffusion des grandes innovations technologiques
(ex. électricité, chemins de fer, informatique).
✅ Selon lui, ces cycles sont inévitables,
quel que soit le système économique, car ils dépendent de tendances profondes
(innovation, investissement, saturation des marchés).
✅ Ses recherches reposaient sur
des études statistiques rigoureuses des données économiques sur
plusieurs décennies.
✅ Ses idées ont été mal vues en
URSS et ont conduit à sa disgrâce et à son exécution lors des purges
staliniennes.
✅ Elles ont ensuite influencé de
nombreux économistes occidentaux, notamment Schumpeter et les
théoriciens de la croissance et de l’innovation.
✅ Aujourd’hui, ses travaux
continuent d’inspirer les réflexions sur les cycles économiques mondiaux et les
grandes vagues technologiques.
6. Illustration schématique
7. Citation emblématique
« Le mouvement de l’économie est régi non seulement par des
causes immédiates, mais aussi par des causes profondes qui se manifestent dans
les grands cycles de l’histoire économique. »
Source : The Long Waves in Economic Life (1925), traduction
anglaise de l’article original publié dans Voprosy Koniunktury.
« Aucun système économique, fût-il le socialisme, ne peut
abolir les oscillations à long terme, car elles sont liées au renouvellement
des bases techniques de la production. »
Source : Cité par Joseph Schumpeter dans Business Cycles (1939),
résumé des thèses de Kondratieff.
« Les cycles longs ne sont pas des phénomènes accidentels ;
ils représentent des lois de la dynamique économique mondiale. »
Source : The Long Waves in Economic Life (1925).
« La succession des vagues de progrès et de crise est une
condition nécessaire du développement de la société humaine. »
Source : Rapport de présentation à l’Institut de Conjoncture de Moscou
(vers 1926), cité dans plusieurs recueils sur l’histoire de l’analyse
conjoncturelle.
8. Pour aller plus loin
🔹 Lire Kondratieff
Si vous lisez l’anglais, son article fondateur est :
- N.D. Kondratieff, The Long
Waves in Economic Life (1925)
C’est le texte qui présente la théorie des cycles longs. Il
est court et accessible (environ 20 pages).
En français, on trouve des résumés et analyses dans :
- Les
grandes crises économiques (ouvrage collectif), chapitre sur
Kondratieff.
- Les
manuels de macroéconomie avancée (ex. Brasseul, Artus).
🔹 Retrouver ses idées
chez d’autres auteurs
Les cycles longs inspirent :
- Joseph
Schumpeter : il parle de destruction créatrice, processus qui
renouvelle l’économie.
- Ernest
Mandel : il reprend la notion de « longue vague » dans une perspective
marxiste.
Pour comprendre l’actualité de sa théorie, on peut se
demander :
✅
Internet et le numérique (années
1990-2020) forment-ils un nouveau cycle long ?
✅
Les énergies renouvelables et l’IA déclenchent-ils une nouvelle phase
ascendante ?
✅
Les crises de 2008 et de 2020 (Covid) marquent-elles le bas d’un cycle ?
Ces questions animent encore les débats en économie.
🔹 Pour approfondir
Vous pouvez explorer :
- Les
publications de la School of Long Waves (école d’économie qui
poursuit ces recherches).
- Les
travaux de Carlota Perez sur les révolutions techno-économiques.
- Les
bases statistiques de l’OCDE et de la Banque Mondiale pour observer les
tendances de long terme.