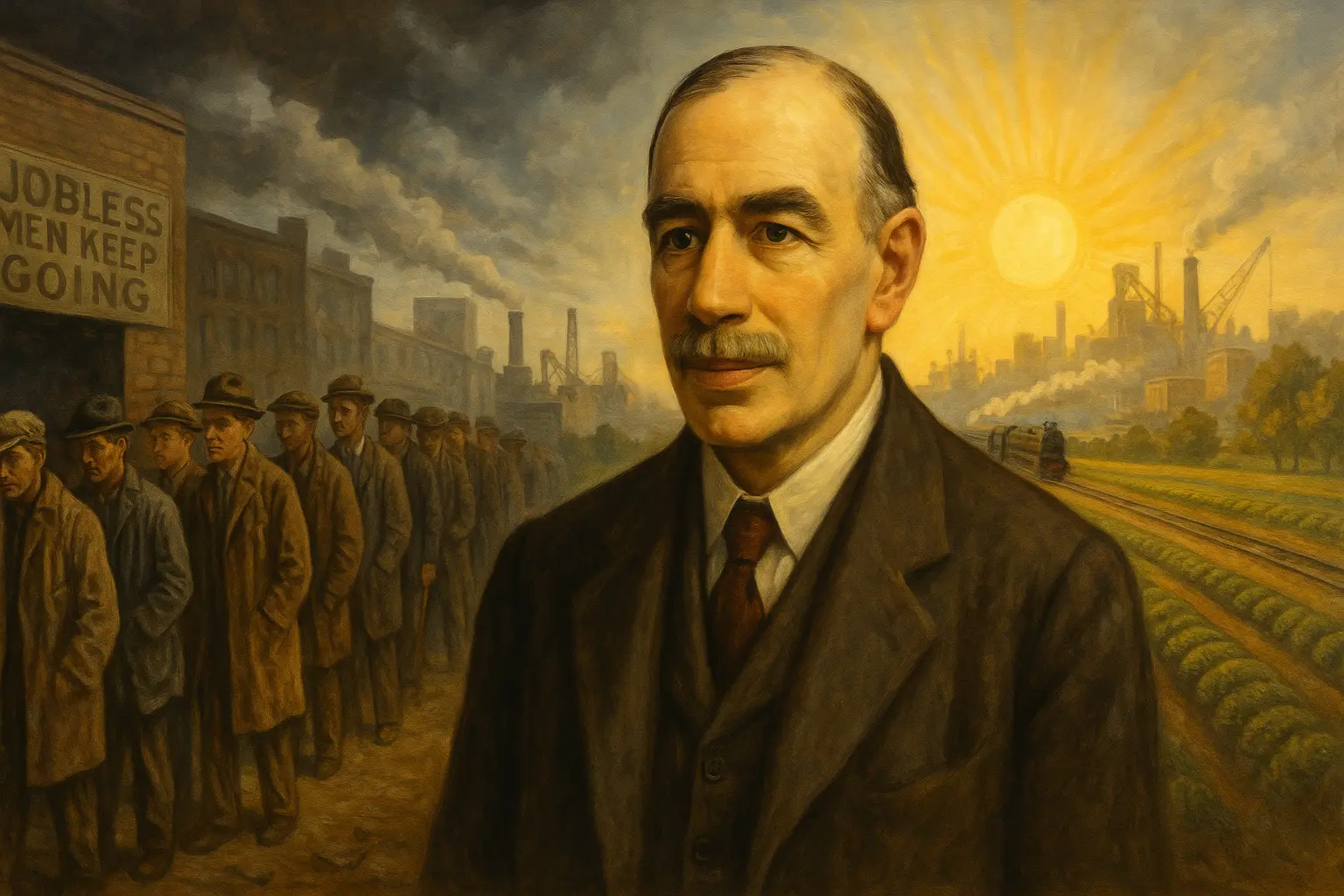1. Nom du courant et période historique
Le keynésianisme est un courant de pensée économique
né dans les années 1930, à la suite de la Grande Dépression. Il doit son nom à
l’économiste britannique John Maynard Keynes, dont l’ouvrage majeur, The
General Theory of Employment, Interest and Money (1936), a profondément
modifié l’analyse économique.
Il apparaît comme une critique directe de l’économie
classique et néoclassique, qui considéraient les marchés comme autorégulateurs
et toujours capables de revenir à l’équilibre. Au contraire, le keynésianisme
soutient que l’économie peut rester durablement en situation de chômage sans
intervention publique.
Ce courant marque une rupture dans l’histoire économique. Il
devient dominant après la Seconde Guerre mondiale, notamment durant les Trente
Glorieuses (1945–1975), période durant laquelle les politiques économiques
s’inspirent largement de ses recommandations.
2. Contexte intellectuel et historique
Le keynésianisme émerge dans un contexte de crise
économique mondiale sans précédent, la Grande Dépression de 1929,
qui provoque une explosion du chômage, la faillite de milliers d’entreprises et
un effondrement de la production.
Face à cette situation, les théories classiques et
néoclassiques dominantes à l’époque — fondées sur l'idée que le marché
s'équilibre seul — se révèlent impuissantes à expliquer la persistance du
chômage de masse. La croyance dans l’autorégulation de l’offre et de la demande
entre en crise.
Sur le plan intellectuel, les économistes n’ont pas
d’outil théorique adapté pour penser une situation de demande insuffisante.
Les modèles classiques ne permettent pas d’envisager un déséquilibre durable du
marché du travail ou des biens. Keynes propose alors une nouvelle manière de
comprendre l’économie.
Le contexte politique joue aussi un rôle : dans les années
1930, face à la montée des tensions sociales et du chômage, les États
cherchent des solutions actives, notamment avec le New Deal de Roosevelt
aux États-Unis.
Enfin, le développement des statistiques économiques
modernes (comme le PIB, les indices de production industrielle ou le taux
de chômage) permet pour la première fois d’observer les grands équilibres
macroéconomiques de manière chiffrée, ce qui nourrit la pensée keynésienne.
3. Principales idées et mécanismes théoriques
Le keynésianisme repose sur une idée simple mais
révolutionnaire pour l’époque : la demande globale détermine le niveau de
production et d’emploi dans une économie. Contrairement aux classiques,
Keynes affirme que l’offre ne crée pas toujours sa propre demande.
Selon lui, l’économie peut rester bloquée dans un équilibre
de sous-emploi. Il ne suffit pas de baisser les salaires pour relancer
l’embauche, car si les ménages gagnent moins, ils consomment moins, ce qui
réduit la demande adressée aux entreprises.
Keynes introduit une distinction essentielle entre épargne
et investissement. Il montre que l’épargne n’est pas automatiquement
réinvestie. Si les entreprises n’ont pas confiance dans l’avenir, elles
n’investissent pas, même si les taux d’intérêt sont bas. Cela peut entraîner un
cercle vicieux de ralentissement économique.
Il insiste aussi sur le rôle central de l’État. Quand
la demande privée est insuffisante, l’État doit intervenir. Il peut le faire
par des dépenses publiques, comme les investissements dans les
infrastructures, ou par des baisses d’impôts pour stimuler la
consommation. Cette politique s’appelle la relance par la demande.
L’idée du multiplicateur est au cœur de ce mécanisme.
Une dépense publique initiale entraîne une augmentation plus que
proportionnelle du revenu national. Par exemple, si l’État construit une école,
cela crée du travail pour les ouvriers, qui consomment ensuite, ce qui soutient
d’autres secteurs.
Keynes propose donc un modèle où l’économie peut être
stabilisée par des politiques budgétaires actives, même si cela implique un
déficit temporaire. Le retour à l’équilibre n’est pas spontané : l’intervention
publique est nécessaire.
4. Auteurs majeurs et œuvres fondatrices
Le keynésianisme prend son nom de John Maynard Keynes
(1883–1946), économiste britannique considéré comme l’un des penseurs les
plus influents du XXe siècle. Son ouvrage majeur est :
- The
General Theory of Employment, Interest and Money (La Théorie
générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, 1936)
Ce livre marque une rupture avec l’économie classique. Il y développe l’idée que l’équilibre économique peut se faire avec chômage, et que l’État a un rôle essentiel à jouer pour relancer la demande.
Keynes s’appuie aussi sur ses travaux antérieurs, comme :
- The
Economic Consequences of the Peace (1919), où il critique le traité de
Versailles et anticipe les déséquilibres économiques à venir.
Après sa mort, plusieurs économistes ont prolongé et
structuré la pensée keynésienne, notamment :
- John
Hicks, qui propose en 1937 une modélisation graphique de la théorie
générale à travers le modèle IS-LM (Investissement–Épargne /
Liquidité–Monnaie). Ce modèle devient un outil standard en macroéconomie.
- Paul
Samuelson, qui intègre les idées keynésiennes dans une approche plus
formalisée et les popularise à travers son manuel d’économie, largement
utilisé dans l’après-guerre.
Ces auteurs ont contribué à faire du keynésianisme une
doctrine dominante dans les politiques économiques des pays développés entre
1945 et 1975.
5. Applications concrètes et politiques économiques
Le keynésianisme a profondément influencé les politiques
économiques dans de nombreux pays à partir de la Seconde Guerre mondiale. Son
application repose sur une idée centrale : l’État doit soutenir la demande
globale pour éviter le chômage et stimuler la croissance.
a. Les Trente Glorieuses (1945–1975)
Pendant cette période de forte croissance en Europe de l’Ouest, aux États-Unis
et au Japon, de nombreux gouvernements appliquent des politiques keynésiennes.
L'État investit massivement dans les infrastructures, l’éducation, la santé et
les grands équipements publics.
- En
France, c’est la période du planisme et de la modernisation de
l’économie avec des investissements coordonnés par l'État (Commissariat au
Plan).
- Aux
États-Unis, les idées de Keynes avaient déjà été expérimentées dès les
années 1930 avec le New Deal de Roosevelt, qui prévoyait des
travaux publics, des aides aux chômeurs et des réformes bancaires.
b. Politique budgétaire active
Les États utilisent les budgets publics comme outils de régulation. En cas de
ralentissement, ils acceptent les déficits pour soutenir l’économie. En période
de surchauffe, ils réduisent les dépenses ou augmentent les impôts pour limiter
l’inflation. Cette approche est appelée politique conjoncturelle.
c. Plein emploi comme objectif prioritaire
Le keynésianisme met l’accent sur la lutte contre le chômage. C’est dans cet
esprit qu’apparaissent des politiques publiques visant à protéger l’emploi, à
soutenir la formation professionnelle, ou à orienter les investissements vers
les secteurs stratégiques.
d. Encadrement du marché
Même si Keynes ne prône pas une économie totalement dirigée, il estime que les
marchés financiers, en particulier, doivent être encadrés. Cela conduit à la
création d’institutions comme le FMI et la Banque mondiale, pensées à l’origine
dans une logique inspirée des idées keynésiennes.
En résumé, le keynésianisme donne naissance à l’État-providence
moderne, avec des politiques actives en matière d’emploi, de redistribution
et de soutien à la croissance.
6. Critiques et limites
Le keynésianisme, dominant après 1945, a été fortement
critiqué à partir des années 1970, à la fois sur le plan théorique et dans ses
résultats pratiques.
a. L’inflation comme conséquence inattendue
Dans les années 1970, de nombreux pays développés connaissent une stagflation
: une situation combinant chômage élevé et forte inflation. Or, selon la
théorie keynésienne, ces deux phénomènes ne devraient pas coexister. Cela remet
en cause l’efficacité des politiques de relance par la demande.
b. La critique monétariste
Des économistes comme Milton Friedman (courant monétariste) reprochent
aux keynésiens de négliger le rôle de la monnaie. Ils estiment que l’inflation
est avant tout un phénomène monétaire, lié à une création excessive de monnaie
par l’État ou la banque centrale. Friedman défend une politique de croissance
monétaire contrôlée et stable, sans intervention budgétaire discrétionnaire.
c. Les anticipations rationnelles
À partir des années 1980, de nouveaux modèles (théorie des anticipations
rationnelles) montrent que les agents économiques (ménages, entreprises) ne se
laissent pas surprendre indéfiniment par les politiques publiques. Si l’État
tente de relancer l’économie par la dépense, les acteurs peuvent anticiper une
hausse future des impôts ou de l’inflation, et adapter leur comportement,
rendant ces politiques inefficaces.
d. L’endettement public
Les politiques de relance peuvent entraîner des déficits budgétaires chroniques
et une hausse de la dette publique. À long terme, cela peut peser sur la
confiance des marchés financiers et limiter les marges de manœuvre de l’État.
e. La complexité de l’intervention
Enfin, certains critiquent les difficultés pratiques à mettre en œuvre une
politique keynésienne "bien dosée" : il est difficile de prévoir le
bon moment pour agir, d’évaluer l’ampleur de l’intervention nécessaire, et d’en
mesurer rapidement les effets.
Malgré ces critiques, de nombreux économistes considèrent
que le keynésianisme reste pertinent, surtout en période de crise.
7. Héritage et postérité
Le keynésianisme a profondément marqué la pensée et la
pratique économiques du XXe siècle, et continue d'influencer les débats
actuels.
a. Un pilier de la macroéconomie moderne
Même si de nouvelles théories sont apparues, la pensée keynésienne reste au
cœur des politiques économiques. L'idée que la demande globale peut être
insuffisante, et que l'État doit intervenir pour la soutenir, est aujourd'hui
largement admise dans certaines circonstances.
b. Le retour du keynésianisme en temps de crise
À chaque grande crise, les États reviennent massivement aux outils keynésiens.
Ce fut le cas :
- En
2008, après la crise financière mondiale. De nombreux pays lancent des
plans de relance budgétaire pour éviter un effondrement de l'activité.
- En
2020, pendant la crise du COVID-19. L'intervention publique a été massive
: aides aux entreprises, soutien aux revenus, investissements publics.
Ces exemples montrent que, malgré les critiques, le
keynésianisme reste une boîte à outils mobilisable en cas de choc économique
majeur.
c. Nouvelles formes du keynésianisme
Des courants récents se revendiquent de Keynes tout en l’adaptant :
- Le néo-keynésianisme
cherche à intégrer les apports des théories récentes (comme les
anticipations rationnelles) dans un cadre plus rigoureux, tout en
conservant l'idée d'une intervention publique stabilisatrice.
- Des
auteurs comme Joseph Stiglitz ou Paul Krugman défendent des
politiques keynésiennes face aux inégalités ou aux crises écologiques.
d. Une influence politique durable
Au-delà de l’économie, le keynésianisme a renforcé la légitimité d’un État
social et régulateur. Il a influencé la construction des systèmes de protection
sociale, le rôle des institutions internationales (FMI, Banque mondiale), et
les objectifs des politiques économiques nationales.
En résumé, le keynésianisme n’est plus hégémonique, mais il
reste vivant, évolutif et régulièrement mobilisé face aux défis
contemporains.
8. À retenir — Synthèse
Voici une synthèse claire et structurée, utile pour la
révision ou la mémorisation des idées clés :
|
Élément |
Contenu essentiel |
|
Période |
Années 1930, en réaction à la crise de 1929 |
|
Fondateur |
John Maynard Keynes |
|
Idée centrale |
La demande globale détermine la production et l’emploi |
|
Rôle de l’État |
Intervention nécessaire pour stabiliser l’économie et
éviter le chômage |
|
Outils utilisés |
Dépenses publiques, baisse des impôts, déficit budgétaire
temporaire |
|
Concepts clés |
Multiplicateur, équilibre de sous-emploi, politique
conjoncturelle |
|
Exemples historiques |
New Deal (USA), Trente Glorieuses (Europe), plans de
relance en 2008 et 2020 |
|
Critiques |
Risque d’inflation, déficit chronique, anticipations des
agents |
|
Héritage |
Encore mobilisé aujourd’hui lors des grandes crises
économiques |
Lexique de base
Demande globale
C’est la somme des demandes adressées aux producteurs d’un pays (consommation,
investissement, dépenses publiques, exportations). Pour Keynes, c’est le
principal moteur de l’activité économique.
Sous-emploi
Situation où tous ceux qui veulent travailler ne trouvent pas d’emploi, même si
les salaires baissent. Keynes considère que le marché du travail ne s’ajuste
pas naturellement.
Multiplicateur keynésien
Mécanisme selon lequel une dépense initiale (par exemple de l’État) entraîne
une augmentation plus que proportionnelle du revenu national. Chaque euro
dépensé circule dans l’économie et provoque plusieurs cycles de
revenus/consommation.
Politique budgétaire
Utilisation du budget de l’État (dépenses et recettes) pour agir sur
l’économie. Elle peut être expansionniste (déficits pour relancer la
demande) ou restrictive (excédents pour freiner l’inflation).
Politique de relance
Ensemble des mesures visant à stimuler l’activité économique en période de
ralentissement (hausse des dépenses publiques, baisse d’impôts, subventions…).
Équilibre de sous-emploi
Situation stable mais insatisfaisante où l’économie fonctionne en dessous de
son potentiel, avec chômage et capacités de production inutilisées.
État-providence
Modèle d’État qui intervient pour garantir le bien-être de la population
(protection sociale, santé, éducation, lutte contre les inégalités…).
Stagflation
Conjonction d’une stagnation économique (ou d’un chômage élevé) et d’une forte
inflation. Cette situation a remis en cause certaines prévisions keynésiennes
dans les années 1970.
9 – Exemple schématique
Ce schéma montre un cycle vertueux :
- L’État
injecte de l’argent via des dépenses.
- Cela
augmente la demande globale.
- Les
entreprises produisent plus et embauchent.
- Les
ménages ont plus de revenus, consomment davantage.
- Ce
qui relance encore la demande.
10. Pour aller plus loin
Voici une sélection de ressources pour approfondir la pensée
keynésienne, sa postérité et ses débats contemporains. Elles peuvent être
utiles aux lycéens, étudiants ou curieux en économie.
Ouvrages clés
- John
Maynard Keynes, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la
monnaie (1936)
— L’ouvrage fondateur du keynésianisme. Dense mais essentiel pour comprendre la rupture avec la pensée classique. - Alain
Parguez, L’État social contre le marché
— Présente de manière claire la logique keynésienne et ses implications sur les politiques publiques. - Paul
Krugman, Lutter contre la dépression (2012)
— Expose pourquoi une approche keynésienne reste pertinente après la crise de 2008.